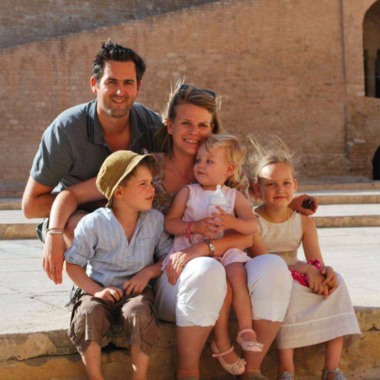De 2003 à 2006, j’étais volontaire Fidesco à Madagascar. Ma femme et moi étions responsables de projets agricoles et agro-alimentaires. Parmi eux, nous avions la charge d’une petite ferme-école qui avait pour mission de diffuser des méthodes d’élevage avicole et apicole. Cette ferme avait été créée dix ans auparavant par un autre volontaire Fidesco à la demande du diocèse qui nous accueillait. La région était particulièrement enclavée. Les méthodes d’élevage étaient rudimentaires et peu optimisées. Régulièrement, la population se trouvait en situation d’insuffisance alimentaire, particulièrement en termes d’apports protéinés. Rationaliser et optimiser la production d’oeufs semblait une voie intéressante pour lutter de manière pérenne contre ce problème. Parallèlement, la possibilité d’offrir aux agriculteurs locaux les moyens de sécuriser des revenus par une production plus importante et constante était également une manière d’améliorer leur niveau de vie. La ferme Saint-François a ainsi été créée pour être un lieu d’expérimentation et de formation des agriculteurs. Les techniques de construction des bâtiments agricoles, produits avec des matériaux locaux facilement accessibles, les méthodes d’élevages, adaptées au contexte, ont été diffusées pendant la dizaine d’années qui a précédé notre mission.
En arrivant sur le terrain, nous constations que la ferme était extrêmement déficitaire. La production d’oeufs et de miel ne suffisait plus à couvrir les frais de fonctionnement. En réalité, les agriculteurs malgaches de notre région s’étaient appropriés notre travail, vendaient leur production sur le marché. Notre ferme n’était plus qu’un acteur parmi d’autres. Pire, nous entrions en concurrence directe avec ceux que nous étions censés soutenir. Nous avons donc décidé d’arrêter cette activité. Le relais était pris par les acteurs locaux : success story ! Success story ?
Nous rêvons tous, au moment de partir en mission, que celle-ci s’achève par une prise de relais des acteurs locaux, l’efficacité de nos projets se mesurant à l’autonomisation des populations que nous sommes venus servir. Dans notre exemple malgache, d’une part il a fallu dix ans pour parvenir à cette autonomie et d’autre part, l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Quinze ans après cet événement, des volontaires Fidesco continuent d’oeuvrer dans cette zone. Est-ce une forme d’acharnement thérapeutique humanitaire ? Sans doute pas. Les besoins sont immenses. Mais la seule raison de la fidélité de Fidesco auprès de ses partenaires réside-t-elle seulement dans l’immensité des besoins ? Ce serait une erreur de le penser.
À la fin de notre mission, la communauté malgache qui nous avait accueillis nous a longuement remerciés. Non pas pour les actions mises en oeuvre dans le cadre de ces programmes agricoles – tout à fait pertinents et utiles – mais pour la fidélité dans le mariage dont ma femme et moi avions témoigné tout au long de cette mission auprès d’eux !
Au fond, cette anecdote met en évidence la question de la finalité des actions de développement et des moyens pour l’atteindre. Quel est l’objectif ultime des projets de développement ? L’aspiration profonde de l’homme est une aspiration au bonheur. Pour y répondre, l’Église nous invite à promouvoir un développement intégral : de tout homme et de tout l’homme1. Qu’est-ce que cela signifie ?
Le but du développement ne peut se limiter à l’augmentation de la richesse économique, mesurée par le PIB. Ni même à l’indice de développement humain qui intègre l’espérance de vie et le taux d’alphabétisation. Tous ces indicateurs sont utiles mais non suffisants. Sommes-nous plus heureux parce que nous vivons vieux et mieux éduqués ? Sans doute un peu mais n’y a-t-il pas des personnes dans l’histoire qui nous ont édifiés par la joie dont elles rayonnaient malgré leur décès précoce ou des études limitées ?
Jean-Paul II a, tout au long de son pontificat, défendu les droits humains car il ne peut y avoir de développement sans respect inconditionnel de la dignité de la personne. Mais cette dignité ne naît pas d’abord d’un ensemble de lois érigées par un droit positif mais du fait que l’homme a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Permettre le développement de tout l’homme et de tout homme, c’est permettre que soit respectée la dignité de chacun. Cela implique que l’on nourrisse toutes ses dimensions : physique, intellectuelle et spirituelle. C’est ce que Paul VI a appelé le « développement intégral ».
Cependant, le développement intégral ne se limite pas à la croissance de « dimensions » de la personne. Il s’agit surtout d’aider chacun à accomplir sa vocation profonde, à déployer toute sa fécondité. Celle-ci n’est pas liée qu’à la force physique, intellectuelle ou spirituelle. L’homme est un être de don, il est fait pour donner et recevoir quel que soit son état de santé, sa capacité intellectuelle ou sa profondeur spirituelle. C’est cette capacité qui lui permet d’entrer en relation sincère et profonde avec chacun de ceux et celles qui l’entourent, de construire une amitié durable source d’un vrai bonheur.
Même avec cette intention, il n’est pas toujours évident de travailler au développement des peuples qui nous accueillent. Dans nos pays de mission, nos partenaires nous remercient toujours de notre venue. Mais il n’est pas rare de rencontrer aussi beaucoup d’hostilité. Nous avons déjà tous entendu ce proverbe qui rappelle que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il y a quelque chose d’humiliant lorsque l’on dépend des autres pour assurer sa survie. Comment faire croître la dignité de celui que nous sommes venus aider ? Peut-être en acceptant de recevoir nous-mêmes l’aide dont nous avons besoin.
Mettons-nous à la place des personnes qui nous accueillent et pour cela, faisons un petit détour par l’Évangile de saint Luc. Lorsqu’un docteur de la Loi répond à Jésus que pour avoir la vie éternelle il faut aimer Dieu et son prochain comme soi-même, il s’interroge immédiatement sur l’identité de ce prochain qu’il faut aimer. Jésus raconte alors la célèbre parabole du bon Samaritain (Lc 10, 29-37) et demande : « Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » La réponse est : le Samaritain, « celui qui a fait preuve de pitié envers lui ». La question et la réponse sont surprenantes tant nous avons pris l’habitude de qualifier de prochain celui que nous devons aider. Jésus nous montre que le prochain que l’on doit aimer est celui qui nous vient en aide. C’est une belle leçon car il est toujours difficile de reconnaître que nous avons besoin d’aide, que nous ne pouvons-nous suffire à nous-mêmes. Le vrai don de soi, pour les volontaires comme pour les organisations de solidarité, consiste souvent à accepter de recevoir ce que les plus pauvres peuvent leur apporter. C’est dans la reconnaissance de notre dépendance réciproque que se bâtissent une véritable amitié et une démarche vertueuse de développement dans laquelle chacun peut apporter la fécondité qu’il porte.
Charles de Foucauld, alors qu’il constate que sa vie n’a pas la fécondité qu’il espère auprès des populations touarègues, tombe malade. Ceux-là mêmes qu’il est venu aider lui apportent le secours nécessaire pour qu’il guérisse. L’expérience de sa vulnérabilité lui permet d’entrer dans une véritable interdépendance avec ces populations. C’est alors que sa mission put porter vraiment du fruit car l’homme se construit, se développe, croît et embellit dans une relation authentique.
L’autonomie des personnes et des peuples que nous visons prend alors une tout autre acception. Il ne s’agit plus seulement d’indépendance, d’affranchissement ou d’autarcie mais de capacité à exercer sa liberté et sa responsabilité, afin qu’émerge une relation pérenne habitée par la vérité. Pour ce faire, l’éducation est un moyen puissant pour grandir en liberté car elle forme l’intelligence et l’âme à choisir le bien et à renoncer au mal ; le développement économique devient vertueux car il permet à chacun d’exercer sa responsabilité ; la santé permet une participation active à la vie sociale et au bien commun.
Ce processus prend du temps. Volontaires et partenaires doivent apprendre à s’apprivoiser, à donner et à recevoir les uns des autres. C’est une expérience de vie qui demande humilité, patience et fidélité. La mission confiée aux volontaires permet, par le travail avec le partenaire – et non pour le partenaire – d’entrer dans cette réciprocité et cette fécondité. Saint Paul nous l’enseigne : « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir (Ac 20, 35). » Notre mission est donc fondamentalement d’aider ces populations à donner à leur tour. Pour cela, il nous faut alors apprendre à recevoir. C’est à cette condition que le développement pourra être un développement intégral qui respecte la dignité de chacun, qui fait grandir humainement et spirituellement ceux qui nous accueillent. Pour les volontaires, il s’agit d’une éducation à la patience, à la disponibilité, bref à l’amour du prochain, de celui qui nous sauve de notre misère en nous montrant le vrai chemin de la joie.
« Le vrai don de soi consiste souvent à accepter de recevoir ce que les plus pauvres peuvent apporter. »