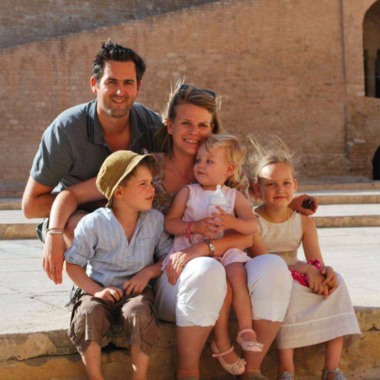Les racines du mal-développement Secrétaire Général de Caritas Internationalis jusqu’en mai 2019, Michel Roy a coordonné durant huit ans l’ensemble des activités de cette vaste confédération mondiale, qui regroupe 165 organisations caritatives et acteurs du développement au cœur de l’Église, dont le Secours Catholique-Caritas France. Propos recueillis par Jean-Luc Moens.
Jean-Luc Moens : Selon vous, quels sont les besoins les plus urgents dans les pays en voie de développement ? Devant quels enjeux sommes-nous placés ?
Michel Roy : Le concept de « pays en voie de développement » me semble dépassé. Il y a des pays qui n’ont pas su s’engager sur le chemin du développement pour de tristes raisons : la corruption des dirigeants (soutenus par des groupes d’intérêt internationaux) qui, au lieu de travailler au bien commun en utilisant au mieux les ressources nationales, particulièrement les ressources minérales, pétrolières et gazières, pratiquent le népotisme, le favoritisme et détournent des sommes considérables à leurs fins personnelles. Ils investissent aussi dans les armes pour garder leurs populations sous contrôle et réprimer dans le sang toute revendication de dignité. On devrait plutôt parler de « mal-développement » quand les secteurs de l’alimentation, de la santé et de l’éducation sont abandonnés. Le besoin le plus urgent est vraiment celui de la gouvernance démocratique et, lié directement à celui-là, la promotion des services de base pour les populations les plus démunies. Les objectifs du développement durable adoptés par les Nations Unies en septembre 2015 représentent assez fidèlement les besoins des populations qui vivent dans la pauvreté et la violence. Un autre grand enjeu pour toute la planète, et tout particulièrement pour beaucoup de pays pauvres des tropiques, qui n’y sont pour rien, est celui de l’inversion de la situation causée par le dérèglement climatique. C’est sans doute l’enjeu le plus urgent. Le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) nous dit dans son dernier rapport que nous n’avons plus que treize ans pour éviter de basculer dans une situation de non-retour si l’élévation moyenne de la température vient à dépasser les 1,5 °C.
Jean-Luc Moens : Quels sont les racines et les principaux facteurs de ce « mal développement » dans les jeunes nations ?
Michel Roy : Les racines du mal-développement sont directement liées au modèle imposé par la mondialisation financière et économique de ces dernières décennies. Tout a été orienté par la recherche du profit : l’accès aux matières premières le plus souvent sur le dos des populations, la délocalisation des industries vers les pays à main-d’œuvre meilleur marché, la violence et la répression, les conflits armés liés au commerce des armes et à une volonté de domination, la sécularisation conduisant à la perte des repères moraux et de la capacité de résistance, la passivité et le fatalisme – même si ces derniers sont moins présents grâce aux progrès de l’éducation.
Jean-Luc Moens : Pourquoi l’Église fait-elle de la solidarité internationale un devoir urgent pour la communauté chrétienne ? Sur quels fondements s’engager dans le service du développement au loin ?
Michel Roy : L’Église est universelle par nature. Dieu est le père de tous les êtres humains, ce qui nous rend tous frères et sœurs dans notre humanité. Personne ne peut être considéré comme moins humain. Tous, nous sommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. Là où la dignité de l’homme est atteinte, l’Église est présente et agit pour rétablir cette dignité. Et l’Église, c’est nous, guidés par Jésus et par nos pasteurs. Cette fraternité nous oblige à nous intéresser à ceux qui sont près comme à ceux qui sont loin. La solidarité est essentielle, et elle ne peut se limiter à un partage d’argent même si cela est nécessaire. Nous sommes invités à nous engager personnellement, en lien avec nos familles et nos communautés. Ici et ailleurs. La « charité » est centrale dans la mission de l’Église. La responsabilité des États est grande : ils représentent les citoyens que nous sommes. Ils doivent œuvrer au bien commun et à l’éradication de l’extrême pauvreté d’ici 2030, comme ils s’y sont engagés en 2015. Mais les services publics, même excellents, ne remplaceront jamais l’attention particulière et l’accompagnement généreux et aimant que les personnes et les familles peuvent donner.
Jean-Luc Moens : Mais comment cet engagement se traduit-il concrètement ? Quel est son impact ?
Michel Roy : L’Église agit dans ce domaine depuis toujours, parce que c’est une mission essentielle, centrale. Elle s’est organisée en conséquence. On peut mentionner les communautés monastiques des premiers siècles, les congrégations religieuses apostoliques dont la qualité du travail dans les champs de l’éducation et de la santé n’est plus à démontrer… et plus récemment, des organisations telles que Caritas dont le pape Benoît XVI a dit en janvier 2013 : « Vous êtes le cœur de l’Église. » Ou encore, Fidesco, qui n’agit pas seulement dans la solidarité concrète, mais avec ce qui caractérise l’Église : avec cœur, un cœur aimant et compatissant. Dans son encyclique Deus Caritas est, le pape Benoît XVI invite à agir avec professionnalisme et coeur1. Le monde actuel a plus que jamais besoin de témoins. Nous agissons parce qu’à la source se trouve Dieu. C’est lui qui donne sens à l’action et à la vie. Nous agissons avec compétence parce que les plus pauvres, marginalisés, vulnérables, ont droit à la qualité de l’accompagnement qui leur est proposé sur le chemin de leur développement intégral. Et nous agissons avec ce plus qui est celui des croyants. C’est dans la qualité de la relation humaine avec les personnes, les familles, les communautés que s’écrit l’histoire du peuple de Dieu. Le cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille et président de Caritas Internationalis, me le disait récemment : ce qui ressort de ses conversations avec beaucoup d’évêques autour du monde, c’est le caractère central de la charité dans la mission de l’Église. Le pape François nous appelle sans cesse à rejoindre les périphéries existentielles et nous invite à faire de l’Église une Église pauvre pour les pauvres. Les pauvres doivent être au cœur de nos sociétés, et non à la périphérie, pour aider la société à devenir pleinement humaine. L’Église en ressort transformée.
« Là où la dignité de l’homme est atteinte, l’Église est présente et agit pour rétablir cette dignité. Cette fraternité nous oblige à nous intéresser à ceux qui sont près comme à ceux qui sont loin. »