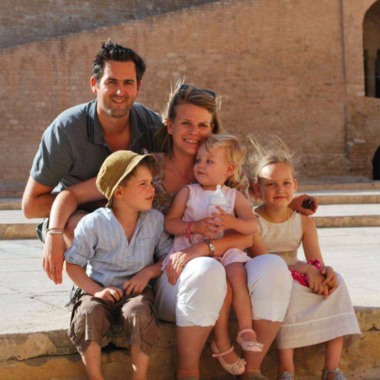Vice-présidente du Secours Catholique-Caritas France, ancienne présidente du CLONG-Volontariat, Louise Avon a acquis une riche expérience des relations internationales en tant que responsable de la Coopération française au Sénégal, puis en tant qu’ambassadeur de France en Lettonie, au Mozambique et au Swaziland. Alexis Béguin est directeur général de l’IECD (Institut Européen pour la Coopération et le Développement), qui a pour objectif de soutenir le développement économique et humain en Afrique subsaharienne, au Proche-Orient et en Afrique du Nord, par le biais de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’entrepreneuriat.
Fidesco : Vous avez tous deux un riche parcours d’engagement. Quelles ont été les étapes clés de ce parcours ? Les situations, les personnes qui vous ont particulièrement touchés ?
Louise Avon : Lors de mes études à Sciences Po, j’ai été frappée par la lecture d’un livre de François Bloch-Lainé intitulé Profession : fonctionnaire1. J’ai alors saisi le sens de l’expression « service public ». J’ai compris que l’on pouvait se mettre au service du bien commun dans le cadre d’un métier, de l’organisation de l’État. Plus tard, au ministère de la coopération, dans divers postes, j’ai découvert à la fois l’Afrique dans la diversité de ses cultures et le travail multilatéral. La participation au travail des agences des Nations Unies et des institutions financières internationales m’a permis de vivre les rapports de force entre États ainsi que l’importance du dialogue et de l’écoute dans les relations internationales. Au Sénégal, pendant six ans, j’ai aussi appris sur le terrain : comment on récolte et transforme le coton, comment sont organisées les coopératives rizicoles, comment les échanges entre communautés villageoises peuvent contribuer à protéger la forêt… J’ai constaté que les relations vraies entre les personnes étaient le véritable moteur du développement. J’ai rencontré des jeunes diplômés, sans travail, d’une banlieue de Dakar, qui s’étaient organisés pour lutter contre l’influence de la drogue dans leur quartier. Nous avons pu les aider à monter un programme de formation et de prévention, puis à créer un centre qui a été inauguré par les présidents Abdou Diouf et Jacques Chirac, et ces activités ont un peu transformé la vie du quartier. La coopération privilégiait cette approche : à partir de rencontres, voir comment accompagner les personnes dans la réalisation de LEUR projet. La coopération est un échec quand elle cherche à imposer son propre projet. Il faut être très respectueux des personnes et de ce qu’elles portent.
Alexis Béguin : C’est la guerre de 2006 au Liban qui a été un tournant dans ma vie. Je travaillais dans ce pays pour une grande entreprise américaine. J’ai été témoin de la destruction, de l’injustice, du mal fait aux plus petits. Avant cette guerre, je vivais dans une bulle. Ce conflit a été un rappel brutal à la réalité, une prise de conscience très forte. Il a été décisif dans mon choix de rejoindre l’IECD. La guerre en Irak puis en Syrie où je travaillais aussi m’a également douloureusement marqué. Les notions de rationalité, de logique, de bien et de mal disparaissent : tout devient justifié. Ce qui m’a mis en mouvement, c’est la volonté de contribuer, d’une manière ou d’une autre, à préserver la vie et la paix. C’est aussi le souci de vérité, la révolte face au mensonge dans la façon dont les conflits étaient présentés et relayés par les médias. Mais le plus dur était d’observer et de vivre la rupture du dialogue entre les différentes communautés et le repli sur soi. Enfin, j’étais saisi par la situation des enfants et des jeunes. J’ai compris la nécessité de leur offrir une éducation de qualité, malgré un contexte catastrophique qui avait en partie détruit leur vie. Leur donner la meilleure éducation possible, c’est leur permettre de sortir des spirales de violence et de haine, pour se bâtir, donner sens à leur existence et s’engager pour le bien.
Fidesco : Aujourd’hui, quel état des lieux pourriez-vous dresser sur notre monde ? Quels enjeux, quelles problématiques vous semblent les plus urgents ?
Louise Avon : Notre monde post-moderne est entré dans une nouvelle étape depuis la fin des années quatre-vingt. Le XXe siècle a alors connu un basculement majeur, avec l’éclatement du bloc soviétique et la chute du mur de Berlin. D’un monde que chacun identifiait bien – politiquement et idéologiquement – avec ses deux blocs, nous sommes passés à un monde émietté, dans lequel chacun est acculé à faire pression sur d’autres, ou à subir la pression de ses proches voisins. Parallèlement, le progrès technique est parvenu à construire un monde de plus en plus interconnecté. Nous sommes donc face à un paradoxe, entre la perte des repères idéologiques, une certaine perte de sens dans chaque société, et une forte accélération des connaissances et des réalisations techniques, que la plupart des personnes ne parviennent pas à suivre par manque d’éducation ou surtout d’argent. L’emballement des techniques et des communications a accéléré un mouvement de confrontation des uns et des autres, sans faire grandir la connaissance mutuelle. Cette distorsion engendre un sentiment d’insécurité, des peurs, des réflexes de défense.
Alexis Béguin : Je vous rejoins entièrement sur ce point. Je suis également frappé par cette accélération dans notre monde où tout va tellement vite. Bien souvent, nous n’avons plus le temps de réfléchir, de nous poser les bonnes questions, d’analyser correctement. Nous sommes pris dans un rythme de vie où tout passe en accéléré : savons-nous où nous courons et pourquoi nous sommes sur cette terre ? Face à la question du sens, l’éducation m’apparaît comme une problématique majeure. Éduquer, c’est permettre aux personnes de se centrer sur l’essentiel, de comprendre et de grandir dans la liberté, la responsabilité, le vivre-ensemble. Notre monde apparaît embourbé dans les conflits, les tensions… La paix semble impossible dans bien des régions. Une analyse en profondeur de la situation permet d’identifier que l’une des causes principales de ces troubles est le manque de dialogue tant au niveau global que local. Aujourd’hui, nous sommes rarement dans un dialogue vrai, celui qui écoute et respecte l’autre dans sa différence. D’ailleurs le mot « diversité » est très utilisé, et pourtant nous sommes dans un monde de plus en plus uniforme, celui d’une société de consommation et de communication à outrance. Le deuxième sujet qui me paraît central c’est la jeunesse et son accès à un travail digne par une formation de qualité. Aujourd’hui, les chiffres sont impressionnants. Selon l’OIT, 275 millions de jeunes sont sans emploi et sans formation dans le monde, et environ 1,4 milliard de personnes occupent un emploi précaire ou vulnérable. Pour prendre un exemple concret, selon une estimation du FMI, en Tunisie, le chômage des jeunes atteint un taux de 30 %, auquel s’ajoutent 30 % d’emplois précaires. 60 % de la jeunesse tunisienne est donc dans une situation vulnérable.
Fidesco : Comment en sommes-nous venus à une croissance qui ne génère pas d’emploi, qui ne profite pas aux plus pauvres ?
Louise Avon : Avec l’effondrement du bloc soviétique, un seul système économique – le capitalisme libéral – s’est emparé de toute la planète. Or, le capitalisme est un système fondé sur l’accumulation. Les difficultés surviennent quand cette accumulation profite à un petit nombre, sans le corollaire de la répartition et du partage. Cette évolution est favorisée par la multiplication des échanges commerciaux mais surtout financiers. La technique permet d’assembler des avions avec des pièces venues de Bulgarie, de Chine, d’Amérique du Sud. Les échanges entraînent des négociations, et dans la négociation celui qui a le plus de cartes en mains est le plus fort. La domination a changé de visage : nous sommes passés de la domination idéologique à la domination de l’avoir. Dans cette course à avoir toujours plus, la finance est allée plus vite que le marché des biens. La financiarisation des échanges est devenue un obstacle à l’économie réelle : l’argent génère de l’argent, et toujours plus d’argent. Les échanges financiers sont commandés par des algorithmes, qui vont plus vite que la personne humaine. Tout cela se rassemble dans un nombre assez limité de personnes qui sont des « anonymes ». Le prix des céréales ou du riz se négocie à Londres, à Chicago, mais c’est rarement au bénéfice des petits producteurs du Congo ou du Mali. Tout étant financiarisé, l’accès aux biens n’est pas du tout égal pour tous. D’où un sentiment de profonde injustice que ressentent beaucoup de populations. Certaines sont même trop faibles pour réagir à cela : c’est le sort des plus démunis. Le vice de forme et de fond du système actuel est la mise en concurrence perpétuelle et instantanée, et ce sont les personnes les plus faibles qui en paient les conséquences. Voilà pourquoi moins de 20 % de la population détient 80 % des richesses mondiales. Aujourd’hui, plus il y a de croissance dans un pays, plus l’écart entre les plus riches et les plus pauvres se creuse. Cette situation est la résultante des mécanismes du système, incapables d’assurer une juste répartition du capital et des revenus.
Alexis Béguin : Le profit ne doit pas être une fin en soi, il doit rester un moyen d’humanisation des sociétés. Plus que les personnes, c’est le système économique actuel qui est en cause, et qui a atteint ses limites. Avant de travailler dans le développement, j’étais financier dans une grande entreprise. J’ai vécu ce basculement d’une approche centrée sur le consommateur et la qualité du produit, à une approche avant tout financière. Il faut revenir à des indicateurs qui sont centrés sur le développement humain et en particulier la question de l’accès au travail, puisque l’un des éléments clés de la réduction de la pauvreté, c’est l’accès à un travail digne. Le mot même de croissance est aujourd’hui associé à celui de progrès. Cela renvoie à l’idée que ce qui va arriver est forcément meilleur que ce qui est là. L’augmentation de la production apparaît dès lors comme un objectif en soi. Le goût du travail bien fait pour la beauté intrinsèque de cette action n’est plus le but de chaque travailleur, comme l’analysait déjà Péguy au XXe siècle2. La perte du travail manuel et cette mentalité moderne d’une croissance pour la croissance sont les raisons principales de cette pauvreté paradoxale qui découle de la croissance. On nous ressasse sans cesse des chiffres de PIB, de RNB, pour parler des progrès réalisés par la croissance, mais plus qu’à ces indicateurs, il faut s’intéresser à l’amélioration de la qualité de vie, au nombre et à la qualité d’emplois créés, au sens donné à travers le travail.
Fidesco : Quelles sont les conséquences concrètes de cette domination du libéralisme financier ?
Louise Avon : L’anonymat de l’argent qui circule favorise la corruption et les trafics. Le commerce des armes est devenu le premier commerce au monde. Le deuxième est celui de la drogue, qui en 2017 représentait 243 milliards de dollars, alors que l’aide publique mondiale au développement s’élevait à 146 milliards de dollars. La traite des êtres humains progresse, elle aussi. Car dans la logique de l’accumulation et du profit, l’être humain devient pour certains une marchandise comme une autre.
Alexis Béguin : Je pense à ce que disait Karl Marx : « Vint un temps où tout ce que les hommes avaient regardé comme inaliénable devint l’objet d’échanges, de trafic et pouvait s’aliéner. C’est le temps où les choses mêmes qui jusqu’alors étaient communiquées mais jamais échangées, données mais jamais vendues, acquises mais jamais achetées – vertu, amour, opinion, science, conscience, etc. – où tout enfin passa dans le commerce3. » Il faut remettre la personne au centre de toutes les politiques de développement économique et de tout projet de développement socio-économique.
Louise Avon : Sur ces grandes tendances transversales, il y a des jeux politiques qui se greffent, en lien avec l’histoire de chaque peuple. L’éclatement des deux blocs a profondément bouleversé les repères dans les rapports entre États. Depuis soixante ans, de nombreux pays qui ont acquis leur indépendance ne parviennent pas à faire suffisamment entendre leur voix dans un système qui leur est imposé. Dans ce contexte, on assiste à une multiplication et à une dissémination des conflits, qui résultent souvent d’un accaparement de terres ou de biens, plus ou moins instrumentalisés, provoquant un important sentiment d’injustice et des drames humains. Les biens communs – la terre, l’eau, l’air – ne devraient être accaparés par personne. Or, la plupart des conflits locaux proviennent des problèmes d’accaparement de ces biens, qui expriment la mainmise d’un pouvoir : je m’empare de ce qui ne m’est pas dû, je prends à l’autre ce qui est sien. Pourquoi les peuples autochtones en Amazonie ne parviennent-ils pas à faire valoir leurs droits sur leur propre terre ? Au Brésil, une loi leur permet de délimiter leur territoire et de faire valoir ces droits. Mais entre-temps, l’État a négocié avec des entreprises multinationales des permis d’arracher la forêt pour faire un barrage, une exploitation de mines, etc. Le dossier de reconnaissance passe alors au dernier plan. La paix est donc un des plus grands enjeux du développement aujourd’hui. L’encyclique Pacem in Terris de Jean XXIII reste d’une grande actualité. Son titre est éloquent : « Sur la paix entre toutes les nations, fondée sur la vérité, la justice, la charité, la liberté .» Comment conjuguer tout cela ? C’est un défi très compliqué, et pourtant, c’est cela, le développement.
Alexis Béguin : Comme vous, il me semble que le vivre-ensemble et la construction de la paix font partie des défis les plus urgents aujourd’hui. On assiste à une croissance des tensions au niveau géopolitique et international. En Afrique subsaharienne, au Proche-Orient, en Afrique du Nord, il existe un certain nombre de conflits qui ne se résolvent pas. Ce sont de grosses échardes dans notre humanité, sources d’injustices et d’incompréhension. De nouveaux conflits apparaissent aussi, y compris chez nous, qui fragilisent les personnes, détruisent des familles et des civilisations, sans qu’aucun projet ne semble se dessiner à l’horizon.
Louise Avon : Voilà pourquoi je pense que le véritable enjeu de notre temps, c’est la démocratie : vivre en sécurité avec un sentiment de justice et de solidarité, en percevant mon voisin non pas comme un étranger, mais comme mon prochain. Pensons à des événements comme le Printemps Arabe : ce qui les a déclenchés, c’est le goût de la liberté. Ces jeunes étaient animés par cet impératif de liberté qui est le propre de l’homme, et qui est présent dans toute civilisation.
Fidesco : La liberté et la démocratie sont-elles synonymes de développement ?
Louise Avon : La question est de savoir vers quoi on se développe. La personne humaine seule a quelque chose que les autres êtres n’ont pas : la liberté, avec son corollaire, la responsabilité. Or, la démocratie est le système qui devrait servir le mieux les intérêts à la fois collectifs et individuels : la sécurité, l’échange, la confrontation pacifique des points de vue. Il ne s’agit pas d’exporter cette démocratie à tout prix, mais de reconnaître qu’elle est un bien précieux. Et cependant, si les démocraties ne parviennent pas à développer des systèmes économiques inclusifs, elles ne seront que des colosses aux pieds d’argile. Certains pays soumis à des régimes très autoritaires réalisent des prodiges de développement économique. La Chine a un fort taux de croissance, et pourtant des dizaines de millions de Chinois vivent dans l’extrême pauvreté. La véritable question est donc : que faisons-nous de notre liberté, de notre capacité d’agir ? Le vrai développement est une loi de la vie : il ne se limite pas à la croissance économique. Pour une personne, se développer, c’est grandir et faire grandir, par tout ce qu’elle apportera aussi aux autres – famille, village, quartier – et c’est ainsi que se développepaiaussi la société. Regardons ce qui se passe en Algérie : pourquoi les jeunes n’en peuvent-ils plus ? Pourquoi cherchent-ils à partir ? Parce que, chômeurs, ils constatent leur incapacité à contribuer à la vie de leur pays, tout simplement. Ils sont privés de cette liberté. « L’expression » vivre ensemble » est un pléonasme », a dit un philosophe. En effet, la sociabilité fait essentiellement partie de l’être humain. Nous sommes des êtres-en-relation. Permettre à des jeunes ou des moins jeunes d’avoir un travail, c’est leur permettre de s’accomplir personnellement, mais aussi de contribuer à la vie des autres, d’avoir un rôle, une reconnaissance sociale.
Alexis Béguin : Sans liberté et responsabilité, on ne peut construire de développement pérenne. Au-delà, la formation et le sens du bien commun tant des dirigeants que de l’ensemble de la population sont des facteurs clés de développement.
Fidesco : Permettre à chacun d’être acteur du bien commun : est-ce ainsi que l’on construit la paix ?
Louise Avon : La clé pour aller vers la paix, c’est la rencontre. Mes actes ont un impact sur d’autres : il faut donc que je connaisse les autres, que je les écoute, que je travaille avec eux. Il faut donner la possibilité au plus grand nombre de contribuer au développement. Cela signifie s’engager auprès des personnes qui ont des projets, qui veulent s’en sortir : les aider à agir localement ensemble, pour améliorer leur environnement immédiat. Servir le développement, c’est accompagner fraternellement la personne dans la réalisation de son propre potentiel. Pas être au-dessus, mais à côté. Ce qui est vrai des personnes l’est aussi des États. Pour que les relations entre États favorisent la paix, le respect de la parole de chacun est indispensable. L’Organisation des Nations Unies, bien que très critiquée, reste une instance intergouvernementale où la parole du plus petit équivaut à celle du plus grand. Le pape Paul VI, dans son discours aux Nations Unies en 1965, a souligné cet aspect important de la reconnaissance de chacun par chacun, et de la volonté de travailler ensemble4. L’exemple des pactes mondiaux est également intéressant. Ces pactes sont méconnus, et pourtant à travers eux s’élabore peu à peu une doctrine qui inclut l’apport de chacun. Le pacte mondial sur les migrations, adopté par l’ONU le 19 décembre 2018, ne va pas révolutionner la vie des migrants, mais il pose des repères sur l’essentiel : comment envisager la migration, son utilité, les difficultés qu’elle engendre. Tout ce qui rentre dans l’échange multilatéral est à cultiver avec précaution. C’est très difficile, mais indispensable si l’on ne veut pas que ce soient quelques méga-multinationales qui fassent la loi dans le monde. Les échanges doivent se faire dans le sens du bien commun et d’un développement durable, c’est-à-dire au profit du bien-être et de la liberté de tous.__ Dans son discours à l’ONU, Paul VI ose dire : « Il est impossible d’être frères si l’on n’est pas humble, car c’est l’orgueil qui brise la fraternité. » La tâche est rude et longue ! Car l’accumulation de l’avoir est motivée par la volonté de puissance : accumuler me donne un pouvoir sur l’autre. Nous sommes loin de l’humilité !
Alexis Béguin : La participation au bien commun est bien évidemment un facteur de paix. Je pense à trois éléments essentiels pour permettre cette participation : l’éducation qui permet à toute personne de donner le meilleur d’elle-même, la famille, atome central de la société et le rôle fondamental des femmes dans l’attention au plus faible et de manière générale dans toute dynamique de développement.
Fidesco : Face à l’état du monde qui pourrait sembler catastrophique, qu’est-ce qui vous pousse à poursuivre votre engagement ? Qu’est-ce qui vous fait espérer ?
Louise Avon : Ce qui me pousse à m’engager, c’est de voir des personnes qui souffrent, quelle que soit leur souffrance. Je trouve la souffrance des autres insupportable. Et la racine de mon engagement, c’est la foi. Je crois que nous avons un seul Père, c’est pour cela que nous sommes frères. Dans Laudato Si, le pape François nous dit : « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer5. » Oui, les choses peuvent changer. Alors, oui, nous pouvons espérer, car même si les conflits, les guerres et l’exploitation des pauvres existent depuis des millénaires, cela fait aussi des millénaires que des personnes luttent et refusent cette situation. L’humanité a donné un saint François d’Assise, un Charles de Foucauld, une Mère Teresa. C’est cela qui donne envie de vivre et d’agir. Et tous les jours, dans les accueils du Secours Catholique, nous voyons des personnes qui ont envie de s’en sortir, avec d’autres. Nos 70 000 bénévoles vivent ce partage, ce chemin avec les plus pauvres. Pour moi, ce sont là les véritables signes d’espérance. Il y a aussi de grands événements qui font espérer : je pense à la rencontre entre le pape François et le cheikh Al Tayeb, recteur de l’université d’Al Azhar, coeur théologique de l’islam, à Abu Dhabi. C’est un signe des temps très fort. Le texte qu’ils ont signé ensemble nous invite à « adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère6 ». C’est un programme d’engagement et de vie !
Alexis Béguin : Nous savons que notre engagement n’est qu’une goutte d’eau dans un océan. Mais l’important, c’est de faire chacun ce que l’on peut, là où l’on est. Il y a près de 8 milliards d’êtres humains sur la terre, et chaque personne est une pépite, capable de réalisations merveilleuses. Ce qui nous fait espérer à l’IECD, c’est ce que nous vivons concrètement au quotidien. Nous accompagnons environ 15 000 jeunes par an. C’est toujours magnifique d’entendre ces jeunes nous dire : « J’ai repris confiance en moi. J’étais dans une situation désespérée, et maintenant je vis décemment. » Je pense aussi au témoignage de personnes en situation de guerre. Nous avons formé beaucoup de cadres infirmières en Syrie qui ont fait le choix de rester, et d’oeuvrer pour leur pays. C’est impressionnant de voir qu’elles gardent la confiance, la foi.
Fidesco : Un proverbe dit : « La forêt qui pousse fait moins de bruit que l’arbre qui tombe. » Peut-on dire qu’une forêt est en train de pousser ?
Louise Avon : Oui, je le pense. Car l’échec du système économique actuel est de plus en plus patent. Les générations qui montent, les jeunes n’en voudront plus. Ils trouveront et inventeront d’autres modes de vivre en société. Je pense que la forêt pousse en permanence. Un de mes amis en Casamance, désespéré de voir la déforestation galopante de cette région, a inventé le système du semis au lance-pierre : avec son équipe, ils partent en voiture juste avant la saison des pluies, et lancent au lance-pierre des boules de feuilles remplies de graines. Des zones entières ont été reboisées ainsi ! Pour nous, c’est la même chose : nous envoyons nos petites bombes de bonne volonté avec nos lance-pierres de la foi et de l’espérance et ça pousse !
Alexis Béguin : Il y a toujours eu des jeunes générations en essor, mais les générations actuelles sont confrontées à des problèmes inédits. Il ne s’agit pas ici de faire pousser une forêt mais de faire en sorte que chaque arbre de la forêt ait un tuteur sur lequel s’appuyer afin de s’épanouir pleinement. Nous semons au quotidien ! L’ensemble des belles œuvres, positives, accomplies tous les jours, tout cela est bien plus grand que le mal que nous voyons autour de nous. Il y a plus qu’une forêt qui pousse : il y a une humanité en mouvement.