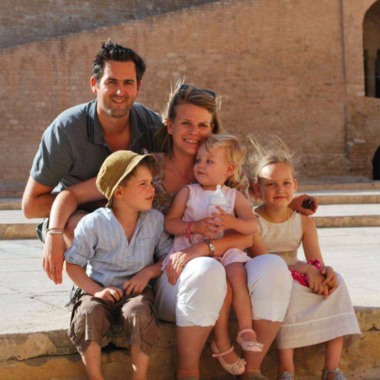Ancien volontaire Fidesco avec son épouse de 2003 à 2006, Johan Glaisner est Directeur Général Adjoint de l’Ircom pour l’Institut Pedro de Béthencourt, qui forme des cadres aux métiers de la solidarité internationale et de l’action sociale. Il nous livre son analyse sur les enjeux du développement et l’engagement de l’Église aujourd’hui.
Dès les années 60, soucieux que les pays nouvellement décolonisés s’autonomisent et ne dépendent pas uniquement du soutien apporté par les pays occidentaux, les programmes de développement sont mis en place dans différents domaines. À l’époque, la question du développement de ces pays est posée principalement en termes de retard économique et technologique. La question de la faim dans le monde est originellement la première qui s’est posée aux acteurs du développement. Comment permettre à chaque personne sur la planète de bénéficier d’une alimentation suffisante, quantitativement et qualitativement, et de conditions de vie satisfaisantes ? Les réponses apportées concernent essentiellement les apports technologiques (entre autres le matériel agricole et industriel), la structuration de l’économie et de la démocratie. On croit alors aux théories du push : il faut investir massivement dans les infrastructures, injecter des capitaux, structurer des filières de production… le développement suivra ! Largement soutenue par les États-Unis et par les anciens pays colonisateurs alliés, cette politique va connaître un retournement lorsqu’au bout d’une dizaine d’années, las d’attendre des progrès significatifs, les pays en développement, que l’on nomme alors le Tiers-Monde, vont se tourner vers la puissance soviétique pour y puiser un nouvel élan. Les dictatures s’installent, le développement n’est toujours pas au rendez-vous. Alors que l’URSS vacille et que les pays de l’Ouest connaissent une première crise suite aux chocs pétroliers, les pays en développement s’enfoncent, au début des années 1980, dans une crise dite « de la dette ». L’écart entre les pays développés et les pays en développement ne cesse alors de se creuser : en 1980, le PIB/habitant de la France est 41 fois celui de la Centrafrique. Il est aujourd’hui 64 fois plus important !
La solution purement économique imaginée dans les années 90 grâce aux programmes d’ajustement structurel proposés par le FMI et la Banque Mondiale va causer énormément de difficultés dans les pays en développement. Les vagues de privatisation des services publics auxquelles les prêts sont alors conditionnés vont profondément déstructurer l’économie de ces pays. La fin des barrières douanières et l’entrée de ces pays sur le marché international, en particulier pour vendre leurs matières premières, imposées par les institutions financières internationales, auront l’effet inverse de celui escompté : la pauvreté s’accroît, les écarts se creusent. Les pays du Sud vendent leur production de matières premières à un prix dérisoire mais doivent acheter aux pays développés des produits manufacturés au prix fort.
En 2000, avec l’entrée dans le nouveau millénaire, les pays membres de l’ONU décident de se lancer dans un programme ambitieux de lutte contre la pauvreté au niveau mondial. Ils définissent les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui devaient être atteints en 2015. Ceux-ci orientent à la fois les acteurs publics et privés dans leur lutte pour le développement. Ils visent à éliminer la faim dans le monde, assurer l’éducation pour tous, promouvoir l’égalité entre les sexes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH, le paludisme et autres maladies, préserver l’environnement et mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Les objectifs n’ont pas été atteints mais de vrais progrès peuvent être notés. Ainsi, le taux d’extrême pauvreté dans les pays en développement, mesuré par le pourcentage des personnes vivant avec moins de 1,25 dollar par jour, est passé de 47 % en 1990 à 14 % en 2015. Après cette première phase, un nouveau consensus international voit le jour en 2015, toujours sous l’égide de l’ONU : les Objectifs du Développement Durable. Avec le renouvellement des objectifs liés à l’élimination de la pauvreté, des maladies, à la lutte pour l’égalité, émergent de manière évidente des objectifs attachés à la préservation de l’environnement et la volonté de construire une économie mondiale durable et respectueuse de la dignité de la personne.
Il faut se réjouir des progrès qui ont été faits ces vingt dernières années dans tous les domaines du développement : santé, éducation et lutte contre la pauvreté. Mais il faut aussi noter que le nombre de personnes exilées n’a cessé de croître. Ce sont aujourd’hui plus de 60 millions de personnes dans le monde qui ont dû quitter leur lieu de vie en raison de guerres, de crises économiques, sociales ou politiques ou de phénomènes climatiques. Par ailleurs, les inégalités s’accroissent. 3,4 milliards de personnes vivent avec moins de 5,50 dollars par jour alors que la fortune des milliardaires dans le monde augmente de 2,5 milliards de dollars par jour. L’effet de ruissellement tant attendu des politiques libérales des institutions internationales ne semble pas tenir ses promesses !
Le problème n’est pas de vouloir construire un monde égalitariste dans lequel chaque personne aurait le même revenu mais de s’interroger sur les causes de ces inégalités, les causes de ces mouvements de population, les causes des difficultés de croissance de certaines zones du monde. Pour comprendre ces causes, arrêtons-nous sur un exemple. Dans la région du Kivu, en République Démocratique du Congo (RDC), une guerre dure depuis plus de quinze ans. Présentée comme une guerre ethnique et tribale, les raisons sont plus complexes. La région du Kivu est riche en minerais. Les entreprises internationales (américaines, européennes et chinoises) se livrent une concurrence sévère pour accéder à ces ressources et en assurer l’exploitation. De nombreux observateurs constatent la recrudescence des conflits lorsque de nouveaux acteurs tentent d’entrer sur le marché. Mais ce que certains dénoncent comme du néocolonialisme ne saurait suffire à expliquer cette situation. Les responsabilités sont aussi portées par les gouvernements locaux qui n’assurent pas une gestion transparente et juste des licences d’exploitations. Certains groupes armés profitent de cette situation pour commettre des exactions dans la zone. Cette guerre met en évidence la convergence d’enjeux multiples mais qui conduisent à l’exode de nombreuses familles. Ces déplacements de populations engendrent des problèmes de malnutrition, des difficultés d’accès à l’eau potable et contribuent à la propagation de maladies. Autre exemple, la guerre civile yéménite a provoqué la diffusion du choléra, obligeant les organisations humanitaires à des interventions extrêmement complexes. L’Arabie Saoudite ayant décrété un blocus, l’aide humanitaire ne parvient pas aux populations, provoquant la pire crise humanitaire actuellement en vigueur selon l’ONU : 7 millions de personnes au bord de la famine, soit un quart de la population, 1 million de personnes touchées par le choléra, etc.
« C’est d’abord la conversion du cœur de l’homme et le respect de sa dignité qui permettront un développement intégral et la paix entre les peuples. »
La guerre au Soudan du Sud, qui est une réminiscence de la guerre de Sécession du Soudan, a pour origine la maîtrise de zones riches en hydrocarbures. Cette guerre civile entre ethnies a pour fond une lutte pour le contrôle des zones pétrolifères et riches en ressources, ou de celles qui constituent un axe stratégique dans l’acheminement de ces matières premières. Ce conflit, le plus meurtrier en Afrique actuellement (300 000 morts), a provoqué une situation d’insécurité alimentaire qui touche plus de 5 millions de personnes, dont 100 000 déclarées en état de famine. Bien que les conditions climatiques et naturelles soient parfois difficiles dans cette zone, la principale cause de cette extrême pauvreté reste le conflit armé. Son origine repose sur la maîtrise des matières premières. Or, celles-ci sont vendues sur le marché international où la plupart des grandes sociétés pétrolières ferment les yeux sur l’origine des hydrocarbures.
Toutes ces situations dramatiques sont de plus en plus difficiles à gérer car les acteurs humanitaires sont entravés dans leurs actions. Comme le rappelait le sociologue Jean Ziegler, la faim dans le monde n’est pas une fatalité. Nous produisons aujourd’hui de quoi nourrir 12 milliards d’êtres humains. Si certains souffrent de malnutrition ou de famine, c’est parce que les structures socio-économiques et politiques mises en place n’assurent pas une distribution juste des ressources disponibles dans le monde. Ce n’est plus aujourd’hui un problème de production agricole mais bien un problème politique, social et économique, voire anthropologique. Toutes ces crises mettent en évidence que la possession de ressources et l’intégration au commerce international ne suffisent pas à éliminer l’extrême pauvreté, les pandémies, les inégalités ou les injustices. Cela nécessite d’abord une volonté de paix, de justice et de solidarité. Or, les inégalités impressionnantes qui marquent le monde actuellement, les poches de pauvreté qui persistent, sont d’abord les conséquences de choix humains, conscients ou inconscients. Lorsqu’il y a une volonté partagée par les acteurs politiques, économiques ou issus de la société civile de lutter contre la pauvreté et ses conséquences, les progrès sont visibles et rapides. Mais lorsque les intérêts personnels priment, les conséquences sont dramatiques et funestes.
Misereor, l’œuvre de l’Église catholique en Allemagne chargée du développement, met en place un plaidoyer pour obliger l’Europe à avoir une meilleure traçabilité des matières premières qui viennent de RDC (surtout le coltan). Les solutions techniques, économiques et juridiques existent mais elles demanderaient de revoir nos modes de consommation car de telles mesures auraient pour conséquence une augmentation des prix des matières premières et donc des produits finis. Les actions pour le développement ne sont pas seulement sur le terrain de pays lointains, elles débutent avec notre porte-monnaie ! Dès 1967, le pape Paul VI affirmait que « le développement est le nouveau nom de la paix ». L’Église, par son enseignement et ses actions, rappelle que le développement de tout l’homme et de tous les hommes passe par l’option préférentielle pour les pauvres, la destination universelle des biens et l’orientation vers le Bien Commun. C’est d’abord la conversion du coeur de l’homme et le respect de sa dignité qui permettront un développement intégral et la paix entre les peuples.
Pour la paix et le développement, l’Église agit de nombreuses manières : – Par des actions locales dans la prise en charge de toutes sortes de vulnérabilités par les dispensaires, les écoles, les maternités, les centres de récupération nutritionnelle, les services sociaux, l’accueil inconditionnel des personnes déplacées ou réfugiées, des personnes en situation de handicap, etc. – Par des actions politiques pour la liberté, à travers des prises de parole décisives dans certaines situations : c’est le cas par exemple en RDC pour dénoncer les manquements à la liberté politique. – Par des actions diplomatiques avec, par exemple, la communauté San Egidio. – Par des actions pour la dignité du travail et l’accès à la terre au Brésil et dans d’autres pays du Sud. – Par des actions de plaidoyer, avec par exemple le travail que fait Portes Ouvertes pour défendre la liberté religieuse, particulièrement dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Ou encore la prise de position du pape François pour encourager au respect de l’environnement dans le cadre d’une écologie intégrale mise en exergue dans l’encyclique Laudato Si. – Etc.
Partout dans le monde, l’Église catholique prend position pour la justice et la paix. Cette prise de position est bien plus qu’une simple déclaration d’intentions. Elle se manifeste par des actions concrètes, multiples et multilatérales. Que ce soit dans l’éducation des consciences, dans les actions concrètes de terrain ou auprès des instances de pouvoir, l’Église vient sans cesse rappeler que sans conversion profonde du coeur des hommes et des femmes, il ne peut y avoir de paix durable et de développement. Cet engagement nécessaire et urgent est l’affaire de tous : chacun est appelé à sa manière à y prendre part.